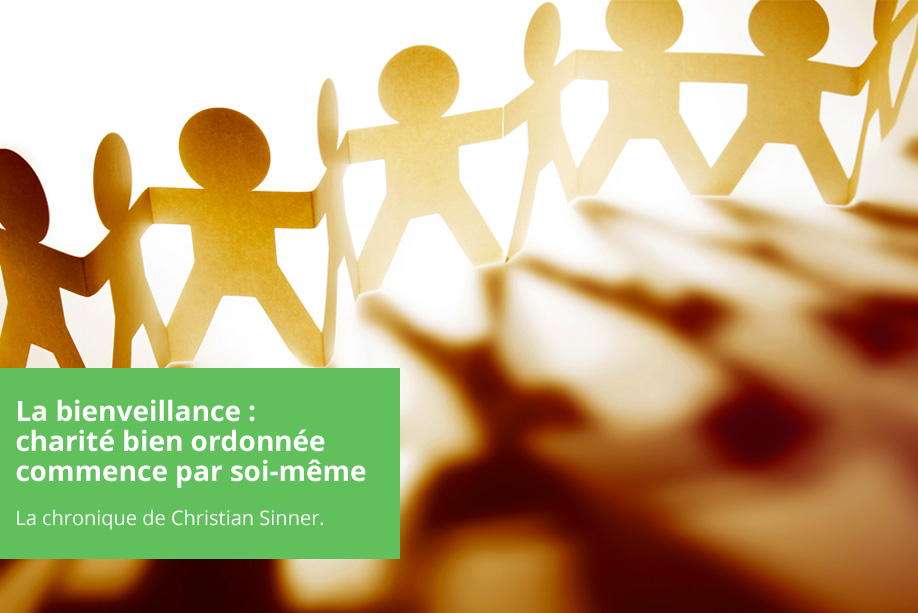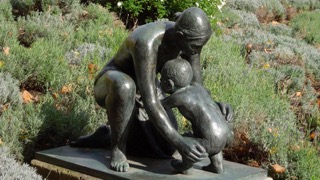La bienveillance, un besoin fondamental qui ne va pas de soi
Si autant d’auteurs et de médias sont amenés à évoquer la bienveillance, c’est que cela ne va pas de soi. Les malveillances, les opposés de la bienveillance, sont vécues, pratiquées, décrites à tout instant et sur tout support, racontées lors d’échanges à la cafétéria ou en partageant des moments avec des proches. Il existe des attitudes ou comportements malveillants volontaires et involontaires, selon Anne van Stappen (1) . La malveillance volontaire, selon ses observations, est souvent liée au désir de pouvoir, de possession, de contrôle, de supériorité. La malveillance involontaire est plutôt consécutive à des négligences ou à l’ignorance des conséquences de nos actes. Notre inconscience en est la source principale, laissant la place à nos automatismes, nos filtres déformants, nos réactions émotives non maîtrisées, bref « à tout ce qui nous fait agir ou réagir en manquant d’humanité, sans qu’on s’en aperçoive » (2), nous confie Anne van Stappen .
Je vous propose une autre approche sociétale fort intéressante, celle de Lytta Basset , théologienne, (Oser la bienveillance, Editions Albin Michel 2014) qui déduit d’une analyse très approfondie et très riche que le dogme du péché originel, adopté au Ve siècle grâce à Saint-Augustin, aurait conditionné l’Occident de manière ininterrompue jusqu’au XXe siècle, en lui donnant sa vision catastrophique de la nature humaine. Ce dogme a contribué à développer le sentiment de culpabilité et le comportement de l’accusation. De nombreux penseurs, au cours des siècles, ont développé la vision que l’homme est fondamentalement égoïste, mauvais, méchant, pervers… Il faudra la rupture de Jean-Jacques Rousseau (XVIIIe), avec son fameux « l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt » pour provoquer une brèche dans cette pensée unique.
Charité bien ordonnée commence par soi-même !
Ce proverbe signifie que la manière dont je m’occupe de moi ne sera pas sans influence sur ma manière de m’occuper des autres. Comment pourrais-je aimer les autres si je ne m’aime pas moi-même ? Il ne s’agit pas de rester focalisé sur soi-même, mais de commencer par prendre soin de soi-même. Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? J’aime beaucoup l’expression utilisée par Anne van Stappen qui précise que « la vraie bienveillance implique d’abord que nous nous libérions de ce qui empêche la Vie de circuler. » Il s’agit de prendre conscience de ses ombres, de ses blessures et souffrances, de ses ruminations et de les considérer comme étant là, présentes par moments, émergentes dans telle ou telle situation, mais comme n’étant pas soi-même ! « Il suffit d’accueillir totalement une douleur pour qu’elle se transforme. Mais il nous faut en enlever, des remparts de protection, et en peler des couches de souffrances ! »
Qui suis-je ? Voilà une question toute simple qu’il est absolument nécessaire de se poser, pour « se décrasser de nos identités parasites qui nous bouchent l’accès à la source », comme le suggère Jacques de Coulon (3). Si les cours de méditation « pleine conscience » foisonnent et sont parfois introduits dans des entreprises, c’est que cette pratique, pour autant qu’elle soit régulière, objet d’une discipline portée par la volonté, est le meilleur moyen de mieux se connaître. Vivre en pleine conscience, c’est acquérir la capacité de s’observer, de percevoir ses émotions, de les identifier, de ne plus se laisser dominer par son mental (Mental FM, comme le dit si joliment Alexandre Jollien). Par la méditation, « je fais place nette en dégageant la « chambre de ma conscience » de toutes les toiles d’araignée qui l’obstruent et de tous les meubles qui l’encombrent pour laisser la lumière de l’être l’éclairer. », comme l'exprime la belle métaphore de Jacques de Coulon.
Pour pratiquer, il faut bien entendu pouvoir quitter le monde de « l’hyper connexion ». Prendre soin de soi, c’est tourner le regard vers le dedans ; il est donc indispensable de se déconnecter de tout ce qui nous sollicite en permanence pour se connecter avec soi-même. C’est là que notre volonté intervient afin de ne pas nourrir la tendance qu’a notre mental à nous chasser de l’ici et du maintenant.
Pratiquer l’auto-empathie pour parvenir à faire preuve d’empathie avec autrui
Pratiquer l’auto-empathie, c’est donc déjà s’accorder du temps, non pas pour le « faire », mais pour laisser la place à l’« être ». C’est aussi ouvrir la porte à « l’acceptation de soi ». Je suis, tout simplement. Je ne suis pas mes sentiments, mes émotions, mes désirs, mes pensées. Je ne m’identifie pas à ce que mon esprit ou mon mental me dicte ; je l’observe, j’en prends note, sans jugement, avec bienveillance. Puis c’est encore ouvrir la porte à la découverte de ses besoins véritables ; je ne parle pas de besoins matériels, ceux qui nous sont constamment éveillés par le marketing et la publicité. « Chercher, lorsque nous souffrons, dans des faux besoins comme la possession de biens matériels, la célébrité, le pouvoir, un statut social valorisant, des diplômes, des drogues légales ou illégales, le soulagement de nos souffrances croyant que ce sont nos véritables besoins, c’est s’enliser davantage dans les ténèbres de notre chaos intérieur. » (4)
« L’auto-empathie, c’est l’art de cultiver un bon égoïsme, ce qui n’a rien à voir avec l’égocentrisme » nous dit Anne van Stappen. Car, « le soin de soi, quand il est fécond, est si nourricier qu’il nous amène naturellement à désirer comprendre l’autre. » Finalement, nos vrais besoins trouvent leurs satisfactions dans l’affectif et le spirituel. Et quand nos vrais besoins sont comblés, c’est l’empathie et la bienveillance envers les autres qui vont caractériser les relations que nous lierons, quel que soit le rôle que nous soyons amenés à tenir dans nos vies très complexes et riches.
(1) Anne van Stappen, docteur en médecine, spécialiste en relations humaines, diverses approches thérapeutiques, formatrice en CNV (Communication Non Violente)
(2) Tiré de "10 vertus pour cultiver son jardin intérieur - Editions Jouvence 2015 - Chapitre "La bien-veillance" de Anne van Stappen
(3) Jacques de Coulon, professeur de philosophie et ancien recteur du collège Saint-Michel à Fribourg - même ouvrage - chapitre "La joie de l'être"
(4) Colette Portelance, docteur en sciences de l'éducation, spécialiste en relations humaines, créatrice d'une approche centrée sur la relation - même ouvrage, chapitre "L'intégrité"
Illustration ci-dessous: statue photographiée par Christian Sinner en Autriche, Vienne, Karlplatz